Jeudi soir 17 avril, j’ai eu le plaisir de participer au débat inauguré par le Museum of Modern Art (MoMA) à New York au cours duquel nous devions discuter de la proposition suivante :
« Le design peut nous permettre d’inclure humainement les produits d’origine animale dans notre alimentation. »
Nicola Twilley était d’accord ; je ne l’étais pas.
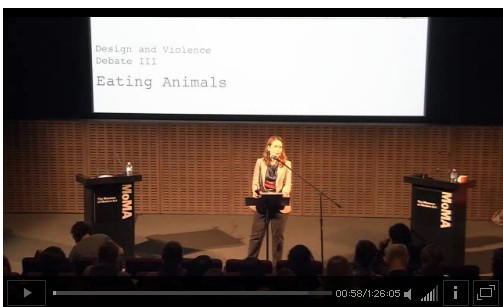 Vous pouvez visionner le débat ici.
Vous pouvez visionner le débat ici.
Comme j’ai tenté de l’expliciter dans ma présentation et lors de la période des questions qui a suivi, je pense qu’il y a trois manières d’interpréter la question : l’une purement empirique ; une autre partiellement empirique et partiellement morale ; et une autre enfin complètement morale.
Premièrement, le design peut-il avoir pour résultat moins de souffrance ? Bien sûr qu’il le peut. Concrètement, nous pouvons concevoir des systèmes d’exploitation qui se traduisent pour les animaux par moins de souffrance. C’est clair. Mais cette interprétation de la question est sans intérêt. Je ne crois pas que Nicola et moi soyons ici en désaccord.
Deuxièmement, nous pouvons nous demander si le design peut réduire la souffrance à un point où nous nous sentirions autorisés à qualifier d’ « humain » le degré d’exploitation. C’est ainsi que j’ai perçu la manière dont Nicola Twilley comprenait la question.
Il s’agit d’une question mixte ayant des composantes à la fois morales et empiriques.
Comme j’en ai discuté au cours du débat, parce que les animaux sont des biens meubles, la question de savoir jusqu’où peut aller l’industrie dans la réduction de la souffrance est bornée par des limitations de nature structurelle. Dans l’ensemble, le traitement « humain » des animaux est limité par l’obligation du rendement économique : nous protégeons leurs intérêts dans la mesure où nous en retirons un bénéfice marchand. Par conséquent, les efforts pour rendre leur traitement plus « humain » sont généralement coextensifs aux efforts menés pour réduire les défauts du système d’exploitation et augmenter ainsi les profits. C’est exactement ce que fait — et reconnaît faire — Temple Grandin, conceptrice d’abattoir et consultante auprès de l’industrie de la viande. Elle travaille à éliminer les imperfections de l’industrie et propose de les réduire à travers un traitement plus « humain » des animaux.
Tant que les animaux seront des biens meubles, la capacité des designers à résoudre le problème sera structurellement limitée. Les animaux les plus « humainement » traités demeurent soumis à ce qu’on appellerait de la torture si des humains en étaient victimes.
La raison principale pour laquelle on pense que le design peut rendre l’exploitation des animaux « humaine » et acceptable sur le plan moral, c’est qu’il se trouve des défenseurs des animaux tels qu’Ingrid Newkirk de PETA, qui apposent leur sceau d’approbation sur des gens comme Grandin et sur les « solutions » qu’elle fournit. PETA a décerné un prix à Grandin, la présentant comme une « visionnaire » et comme « la plus grande experte mondiale du bien-être des bovins et des porcs. »
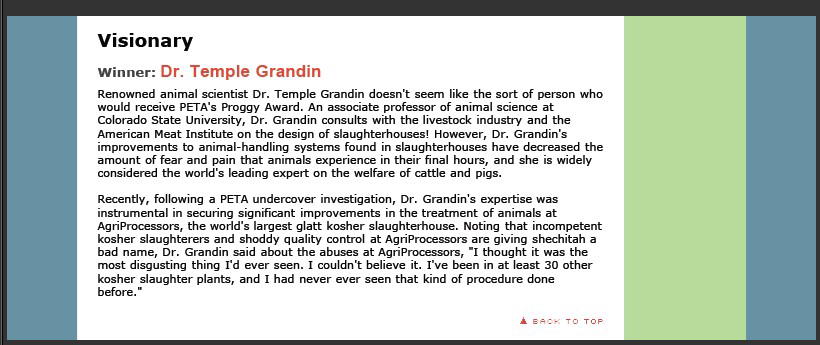 Cela suppose non seulement que le « bien-être » est compatible avec l’exploitation, mais que les consultants qui cherchent à augmenter la rentabilité de l’industrie de la viande ont quelque chose à nous dire sur le bien-être des animaux en tant que question morale. Cela établit et renforce l’idée qu’on peut exploiter les animaux « humainement » de cette manière mixte empirique et morale. A mon avis, c’est tout simplement faux autant au niveau empirique que moral.
Cela suppose non seulement que le « bien-être » est compatible avec l’exploitation, mais que les consultants qui cherchent à augmenter la rentabilité de l’industrie de la viande ont quelque chose à nous dire sur le bien-être des animaux en tant que question morale. Cela établit et renforce l’idée qu’on peut exploiter les animaux « humainement » de cette manière mixte empirique et morale. A mon avis, c’est tout simplement faux autant au niveau empirique que moral.
Bien que l’éloge de Newkirk à Grandin soit apparemment déconcertant, il est parfaitement logique. Il s’agit ici de relation symbiotique. L’industrie a besoin de welfaristes comme Newkirk pour donner à ses efforts d’efficacité une caractérisation morale positive. L’industrie doit fournir de tels efforts pour être pleinement rentable, et ces efforts ont pour résultat des changements mineurs déclarés « humains » par des personnes reconnues comme étant des défenseurs des animaux. Inversement, PETA a besoin de l’industrie en ce sens qu’elle utilise ses mesures d’efficacité pour proclamer que des « progrès » ont lieu et recueillir ainsi des fonds. Dans la plupart des cas, les campagnes organisées par les associations de protection des animaux ciblent les pratiques industrielles économiquement vulnérables précisément pour cette raison. C’est du pain bénit pour les associations, qui annoncent à leurs adhérents des « victoires » faciles afin de faire le plein de dons.
Comme je l’ai dit au cours de ce débat comme dans mes travaux universitaires et sur mon blog, je considère les actions de groupes tels que PETA hautement problématiques. Je pense que c’est une terrible erreur — et ce quelle que soit la circonstance — de dire que certaines formes d’exploitation qui sembleraient à première vue « meilleures » que d’autres devraient être normativement avalisées, étant donné qu’elles impliquent toujours la violation des droits fondamentaux des animaux. Dire d’un propriétaire d’esclaves qui frappe ses esclaves cinq fois par semaine qu’il est « mieux » que celui qui les bat six fois, ne signifie pas que le premier pratique une forme « humaine » d’esclavage, ni que l’esclavage « meilleur » soit moralement acceptable, ni qu’un propriétaire d’esclaves « meilleur » doive être appelé « visionnaire ».
Troisièmement, on peut interpréter la question de la façon suivante : le design pourrait-il un jour rendre éthique la consommation des animaux ? Ce qui fait d’elle une question purement morale.
Comme je l’ai expliqué au cours du débat, je crois que nous avons déjà répondu à cette question : notre sagesse conventionnelle pose que nous ne devons pas imposer de souffrance et de mort « non nécessaires » aux animaux. Quoi que l’on entende par « nécessité », elle exclut de toute façon la souffrance et la mort données par plaisir ou commodité — sinon la norme morale condamnant l’infliction sans nécessité de souffrance et de mort se vide de son sens.
Or, quelle est notre justification pour infliger chaque année souffrance et mort à 58 milliards d’animaux terrestres ainsi qu’à mille milliards environ d’animaux marins ?
Nous n’avons pas besoin de manger les animaux ni de produis d’origine animale pour avoir une santé optimale ; au contraire, le milieu médical reconnaît de plus en plus qu’ils nous sont nocifs. En résumé, les produits d’origine animale ne nous sont nullement nécessaires, à aucun niveau.
Quant à l’agriculture animale, elle représente sans l’ombre d’un doute un désastre écologique.
Par conséquent, quelle est notre meilleure justification pour infliger — fût-ce « humainement » — souffrance et mort à tous ces êtres sentients (subjectivement conscients) ?
La réponse en est qu’ils ont bon goût. Nous retirons de la consommation des animaux un plaisir gustatif.
Or, personne n’accepterait une telle justification dans aucun autre contexte. Pensez à Michael Vick, le joueur de football qui a organisé des combats de chiens. Tout le monde s’est opposé à ce qu’il a fait.
Pourquoi ?
Parce qu’il a infligé des souffrances aux animaux sans autre raison que celle de son plaisir.
Mais quelle est la différence entre s’asseoir autour d’une fosse pour regarder des chiens s’entretuer et s’asseoir autour d’un barbecue où rôtissent des cadavres d’animaux, boire du lait et manger du fromage ? Dans tous ces cas des animaux ont souffert et sont morts — fût-ce dans les plus « humaines » circonstances.
Il n’y a donc aucune différence. Et comme tout étudiant en droit de première année vous le dira, il importe peu que Mary ait tiré sur Joe avec préméditation ou qu’elle ait engagé Alan pour le faire à sa place : c’est un assassinat dans les deux cas. Il peut y avoir une différence psychologique entre la personne qui commet un acte violent et celle qui en paie une autre pour le commettre à sa place ; mais il n’y a certainement aucune différence morale entre les deux, ce qui explique pourquoi la loi les traite de la même façon.
Je dirais donc que la réponse à la question morale posée par ce débat au MoMA est simple : non.
Si les animaux comptent moralement, nous avons l’obligation morale de ne leur imposer ni souffrance (quel qu’en soit le degré) ni mort, du moins en l’absence d’un véritable conflit où il y aurait contrainte. Et cela n’est certainement pas le cas en ce qui concerne notre consommation d’animaux.
Donc je résume : si d’une part vous prenez les questions morales au sérieux, et si d’autre part vous estimez que les animaux ont une valeur morale, alors devenez végan. C’est la seule option qui soit cohérente avec ce que nous disons — avec ce que vous dites — quant au statut moral des animaux. Tout autre comportement en dehors du véganisme signifie que vous admettez que les animaux comptent moralement, mais que vous pensez avoir le droit de ne pas respecter leurs intérêts fondamentaux pour des raisons triviales. Cela n’a pas le moindre sens.
Je remercie Paola Antonelli, Michelle Fisher ainsi que toutes les personnes formidables du MoMA pour avoir organisé cette conférence.
*****
Si vous n’êtes pas végan, devenez-le s’il vous plaît. Le véganisme est une question de non-violence. C’est d’abord une question de non-violence envers les autres êtres sentients. Mais c’est aussi une question de non-violence envers la terre et envers vous-même.
Le monde est végane ! Si vous le voulez.
Gary L. Francione
Professeur distingué, Rutgers University
©2014 Gary L. Francione
